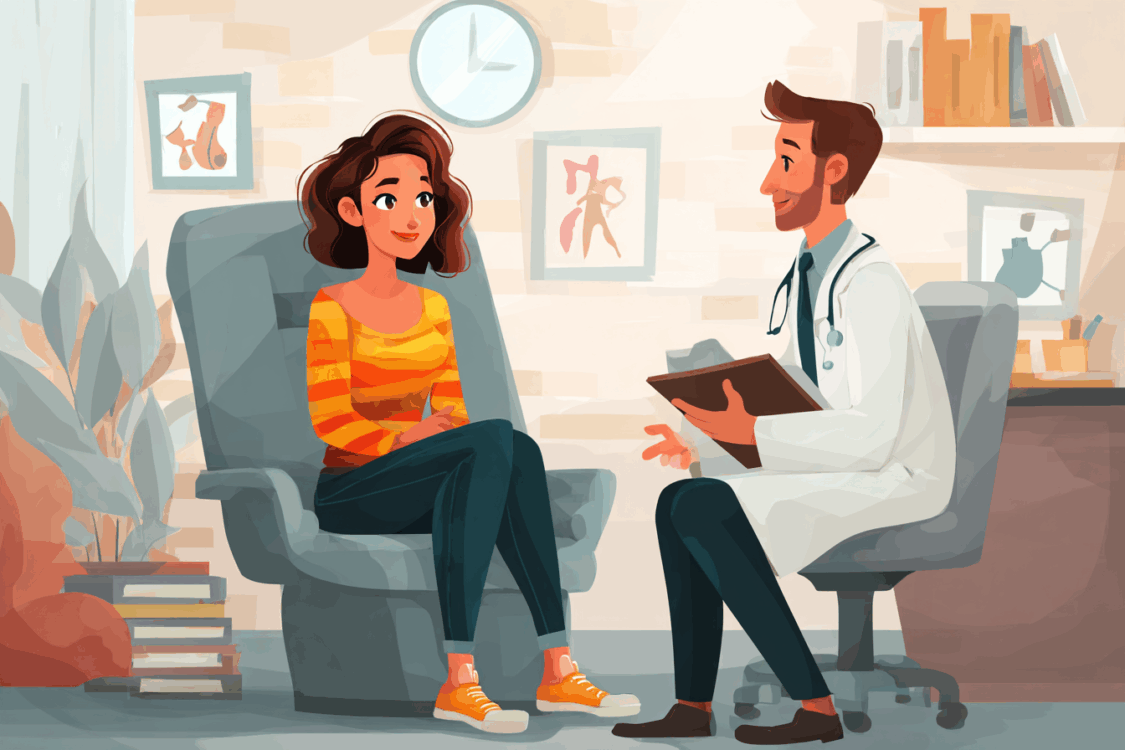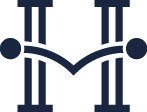Quels sont les troubles urinaires les plus courants chez la femme ?
1. Incontinence urinaire
L’incontinence urinaire correspond à une perte involontaire d’urine. Elle peut prendre plusieurs formes :
- L’incontinence d’effort : les fuites surviennent lors d’un effort physique comme la toux, le rire, le sport ou le port de charges. Elle est liée à une faiblesse du plancher pelvien ou du sphincter urinaire.
- L’incontinence par impériosité : elle se manifeste par un besoin soudain et urgent d’uriner, parfois sans avoir le temps d’atteindre les toilettes. Elle est souvent liée à une vessie dite « hyperactive ».
- L’incontinence mixte : elle combine les deux formes précédentes.
2. Pollakiurie
La pollakiurie désigne une fréquence urinaire anormalement élevée. La patiente ressent le besoin d’uriner très souvent, parfois toutes les heures, mais en faible quantité. Cela peut nuire considérablement à la qualité de vie.
3. Nycturie
La nycturie est le besoin de se lever une ou plusieurs fois la nuit pour uriner. Elle perturbe le sommeil et peut provoquer une fatigue chronique.
4. Urgenturie
C’est une sensation brutale et irrépressible de devoir uriner. Elle s’accompagne parfois d’incontinence si les toilettes ne sont pas accessibles immédiatement.
Quelles sont les causes de ces troubles ?
Les troubles urinaires ont des causes multiples. Les plus fréquentes sont :
- Affaiblissement du plancher pelvien : il peut résulter des grossesses, de l’accouchement, de la ménopause ou simplement du vieillissement naturel des tissus.
- Infections urinaires répétées : elles peuvent entraîner une irritation chronique de la vessie.
- Modifications hormonales : la baisse des œstrogènes à la ménopause modifie la muqueuse urinaire et vaginale, favorisant les troubles.
- Pathologies neurologiques : certaines maladies comme la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson affectent le contrôle de la vessie.
- Chirurgies pelviennes ou radiothérapies : elles peuvent altérer les structures nerveuses ou musculaires impliquées dans la continence.
- Facteurs aggravants : surpoids, constipation chronique, toux répétée, diabète mal contrôlé.
Comment poser le diagnostic ?
Le diagnostic repose avant tout sur une consultation spécialisée. L’urologue ou le gynécologue commence par un interrogatoire précis :
- fréquence des mictions
- existence de fuites, d’urgence, de douleurs
- habitudes de vie (boissons, médicaments, antécédents)
Puis un examen clinique évalue la tonicité périnéale. Selon les cas, des examens complémentaires peuvent être demandés :
- Calendrier mictionnel sur 3 jours
- Bilan urodynamique pour analyser le comportement de la vessie
- Échographie pelvienne ou endovaginale
Quelles solutions pour soulager les troubles urinaires ?
1. Rééducation périnéale
C’est le traitement de première intention dans de nombreux cas. Elle est assurée par des kinésithérapeutes spécialisés ou des sages-femmes. Les techniques utilisées :
- exercices de Kegel
- électrostimulation
- biofeedback
Cette prise en charge vise à renforcer les muscles du plancher pelvien pour mieux contrôler les fuites.
2. Mesures hygiéno-diététiques
Des ajustements simples peuvent améliorer les symptômes :
- boire régulièrement mais éviter les excès le soir
- réduire les excitants (café, thé, alcool, tabac)
- éviter la constipation
- perdre du poids si nécessaire
3. Traitements médicamenteux
Pour les troubles liés à la vessie hyperactive, plusieurs classes de médicaments existent :
- Anticholinergiques : solifénacine, oxybutynine…
- Bêta-3 agonistes : mirabégron
Des traitements hormonaux locaux (ovules ou crèmes à base d’œstrogènes) peuvent être utiles après la ménopause.
4. Traitements mini-invasifs
Quand les médicaments échouent, d’autres options sont possibles :
- Injections de toxine botulique dans le détrusor vésical (muscle de la vessie)
- Neuromodulation tibiale (stimulation par électrodes) ou sacrée (pose d’un neurostimulateur)
5. Chirurgie
En dernier recours, la chirurgie peut être envisagée, notamment pour l’incontinence d’effort :
- pose de bandelettes sous-urétrales
- colposuspension
- implantation d’un sphincter urinaire artificiel (cas rares)
Vie quotidienne et accompagnement
Les troubles urinaires ne doivent pas être une fatalité. En parler avec un professionnel est essentiel pour trouver une solution adaptée. Des protections adaptées, des aides techniques (alèses, coussins ergonomiques) ou le soutien de groupes de parole peuvent également améliorer le vécu des patientes.
Quand consulter un spécialiste ?
- Si les troubles sont fréquents ou handicapants
- En cas de fuites régulières ou d’urgence incontrôlable
- Si les traitements de première intention échouent
- Après la ménopause ou après un accouchement