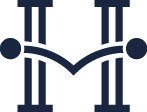Épidémiologie et mécanismes physiopathologiques
La prévalence de la DE après prostatectomie varie selon :
- Le type de chirurgie (ouverte, laparoscopique, robot-assistée)
- Le statut érectile préopératoire
- L’âge du patient
- La qualité de la préservation des bandelettes neurovasculaires
La DE post-prostatectomie résulte :
- D’une atteinte des nerfs caverneux (neuroapraxie temporaire ou permanente)
- D’une hypoxie des corps caverneux secondaire à l’absence d’érections
- D’une fibrose pénienne progressive si absence de traitement
Évaluation pré-opératoire : une étape essentielle
Avant l’intervention, une évaluation fonctionnelle érectile est indispensable :
- Score IIEF-5
- Évaluation des comorbidités (diabète, HTA, dyslipidémie)
- Attentes et projet sexuel du patient
Cela permet d’adapter les objectifs de récupération et d’anticiper le suivi.
Préservation nerveuse : rôle central du geste chirurgical
La préservation des bandelettes neurovasculaires est le facteur prédictif majeur de récupération. En chirurgie robotique, la vision 3D et la précision des gestes favorisent cette conservation, quand elle est oncologiquement possible.
- Préservation bilatérale : meilleure récupération
- Préservation unilatérale : récupération possible mais plus lente
Les techniques dites « intrafasciales » ou « interfasciales » sont utilisées selon le risque tumoral.
Prise en charge post-opératoire : les piliers
1. Réhabilitation pénienne précoce
Le concept de réhabilitation pénienne post-prostatectomie vise à restaurer une oxygénation régulière des corps caverneux, via :
- Inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (IPDE5) en traitement quotidien ou à la demande (sildénafil, tadalafil)
- Injections intracaverneuses de prostaglandine E1 (alprostadil)
- Dispositifs vacuum favorisant l’afflux sanguin
L’instauration de ces traitements doit être précoce (dans les semaines suivant la chirurgie) pour éviter la fibrose.
2. Soutien psychosexologique
Un accompagnement psychologique, seul ou en couple, est souvent nécessaire :
- Réassurance, gestion de l’anxiété de performance
- Réajustement des attentes sexuelles
- Redéfinition de l’intimité
3. Suivi régulier multidisciplinaire
- Urologue : adaptation du traitement en fonction des résultats
- Médecin généraliste : prise en charge des facteurs de risque
- Sexologue : soutien à long terme
Résultats et facteurs pronostiques
- Récupération érectile à 1 an : 30 à 60 % selon les séries
- Amélioration progressive jusqu’à 24 mois
- Meilleur pronostic si patient jeune, bon score IIEF préopératoire, préservation bilatérale
Traitements de 2e ligne et options chirurgicales
Chez les patients sans réponse aux traitements médicaux :
- Injections intracaverneuses de 2e intention (bimix, trimix)
- Implant pénien : prothèse semi-rigide ou gonflable, avec un taux élevé de satisfaction en cas d’échec des autres méthodes
Innovations et perspectives
- Utilisation de facteurs de croissance nerveuse (NGF) en injection locale (en étude)
- Cellules souches et thérapies régénératives (essais en cours)
- Électrostimulation périnéale comme adjuvant à la récupération
- Plateformes de suivi numérique et d’intelligence artificielle pour adapter les protocoles de réhabilitation
Conclusion
La dysfonction érectile post-prostatectomie reste un enjeu majeur pour la qualité de vie des patients. Une prise en charge intégrée et proactive, débutée précocement, augmente significativement les chances de récupération. Les innovations biomédicales et numériques ouvrent la voie à une urologie fonctionnelle de plus en plus personnalisée.